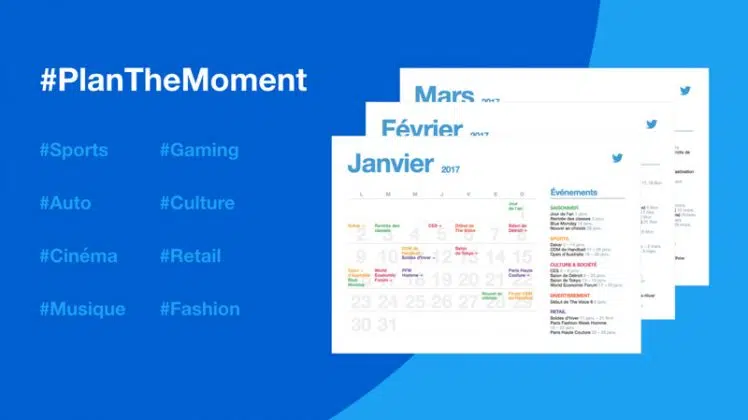Un euro de moins sur la fiche de paie, et c’est tout un système qui vacille. Voilà la réalité brute de la journée de carence dans la fonction publique : à chaque arrêt maladie, le couperet tombe, sans exception ni compensation. Depuis 2018, cette règle s’est invitée dans le quotidien de millions d’agents, réinstaurant une retenue supprimée quelques années plus tôt. Fait notable : la mesure s’efface face aux arrêts pour maladie professionnelle ou maternité, mais reste intraitable pour tout le reste.
Les agents précaires, ceux à temps partiel ou en contrat court, encaissent le choc de plein fouet. Les syndicats parlent d’une règle qui frappe à l’aveugle, tandis que la Cour des comptes y voit un outil de gestion. Entre lutte contre l’absentéisme et maintien d’un filet social, la tension ne faiblit pas.
La journée de carence dans la fonction publique : origine et cadre légal
La journée de carence n’est pas tombée du ciel : sa réintroduction en 2018 marque un tournant dans la gestion du service public. Le gouvernement a clairement affiché son intention de responsabiliser les agents publics lors des arrêts maladie ordinaires, tout en cherchant à limiter la facture pour l’État employeur. Cette journée non payée, prélevée dès le premier jour d’absence, place désormais les agents publics sur le même pied que les salariés du privé, soumis à une règle comparable depuis la fin des années 70.
Portée par le projet de loi de finances sous l’impulsion du Premier ministre et du ministre de la Fonction publique, la carence s’inscrit dans le droit français. L’idée, déjà évoquée sous la présidence de Nicolas Sarkozy, avait été effacée en 2014, avant de faire son retour sous le mandat d’Emmanuel Macron. Ce retour s’inscrit dans une stratégie plus large : rapprocher les régimes public et privé, moderniser la gestion des ressources humaines dans l’administration.
L’article 115 de la loi n° 2017-1837 pose les bases : la retenue s’applique à tous les agents publics, titulaires comme contractuels, en dehors de rares exceptions. Aucun traitement indiciaire ni indemnité ne vient atténuer la perte. Cette règle s’ajoute à d’autres mesures de la loi de transformation de la fonction publique, qui reconfigurent les droits et devoirs de ceux qui servent l’État, les collectivités ou les hôpitaux.
La journée de carence s’inscrit, en réalité, dans un mouvement de fond. Le service public évolue, sous la pression du PLF et de choix politiques assumés. Les lignes de fracture sont nettes : entre gouvernement, syndicats de fonctionnaires et experts, le dialogue tourne parfois à la confrontation.
Quels impacts concrets pour les agents publics, notamment les plus fragiles ?
Impossible d’ignorer l’effet immédiat : chaque arrêt maladie entraîne une retenue automatique sur la rémunération, sans distinction entre cadres, contractuels ou titulaires. Pour un salarié du privé, rien de neuf. Mais lorsque la fonction publique applique cette logique, la conséquence est directe, surtout chez les plus exposés : agents à temps partiel, contractuels, personnes en situation de handicap.
La couverture sociale varie fortement d’un agent à l’autre. Certains profitent d’une protection complémentaire, d’autres non. Perdre un jour de traitement, même si la somme semble modérée, peut déséquilibrer un budget déjà serré. Face à ce risque, les arrêts courts se multiplient, certains agents diffèrent même leur arrêt ou continuent de travailler malades, quitte à y laisser leur santé. Les syndicats pointent un effet inattendu : le présentéisme gagne du terrain, avec un impact direct sur la qualité de vie au travail.
Quelques conséquences concrètes émergent, particulièrement pour les agents fragilisés :
- Les agents en fin de droits ou confrontés à une longue maladie voient leur situation financière se dégrader davantage.
- Selon le secteur et le niveau de revenu, les systèmes d’indemnisation des arrêts maladie couvrent ou non ces situations, générant des inégalités.
La question n’est donc pas seulement budgétaire. Le rôle de la sécurité sociale et de l’assurance maladie est remis sur le devant de la scène. De nombreux agents dénoncent ce qu’ils perçoivent comme une double peine : sanction financière, mais aussi sentiment d’être abandonnés par l’institution. La fonction publique avance, tiraillée entre la nécessité d’assurer le service et celle de protéger ses agents face aux aléas de la vie.
Conséquences sociales et économiques d’une indemnisation réduite
La réduction de l’indemnisation liée à la journée de carence répond à une logique d’économie budgétaire, défendue par les gouvernements successifs. Les rapports de la Cour des comptes et de l’IGAS font état d’économies chiffrées à plusieurs centaines de millions d’euros chaque année. Mais derrière ces chiffres, le quotidien des agents, lui, ne se mesure pas en colonnes de bilan.
Dans la fonction publique territoriale, au sein des petites collectivités, la baisse de revenu lors d’un arrêt court frappe des agents déjà fragilisés. Certains préfèrent ne pas s’arrêter, pour ne pas subir une perte de salaire, quitte à travailler malades et à faire baisser la qualité du service rendu. Pour d’autres, l’absence se prolonge, faute de pouvoir revenir dans de bonnes conditions.
Cette situation entraîne des effets en chaîne :
- La gestion des ressources humaines se complique : les équipes doivent sans cesse s’adapter pour combler les absences imprévues.
- Le déficit de la sécurité sociale ne se résorbe pas pour autant, malgré les économies réalisées sur le papier.
Les analyses de l’INSEE et de l’IGF montrent que si la mesure a un effet limité sur le volume des arrêts maladie, elle ne règle en rien les causes profondes de l’absentéisme. Encore une fois, le débat se déplace : comment le service public peut-il continuer à remplir ses missions tout en préservant la santé de ses agents, dans un contexte où les attentes des usagers ne cessent de grandir ?
Syndicats, Cour des comptes : des visions opposées sur la santé au travail
La journée de carence concentre toutes les tensions du débat public. Pour la Cour des comptes, la règle a une vertu pédagogique : elle responsabilise, limite les abus, rapproche public et privé, et contribue à contenir la dépense publique. Pierre Moscovici, à la tête de l’institution, insiste sur la nécessité de mieux gérer les absences, d’adopter une logique de rigueur.
Les syndicats, eux, refusent cette analyse. CGT, CFDT, UNSA, tous dénoncent une disposition qu’ils jugent injuste et qui touche surtout les agents les plus vulnérables. Selon eux, la journée de carence ne s’attaque pas aux racines de l’absentéisme et n’apporte aucune réponse en matière de prévention des risques professionnels. Leur exigence : repenser la santé au travail, miser sur des conditions de travail dignes, non sur la sanction en cas de maladie.
Les discussions à l’Assemblée nationale sur les lois de finances, tout comme le récent débat autour de la réforme des retraites, illustrent ce clivage persistant. Le gouvernement défend la transformation de la fonction publique, au nom de la rationalisation des dépenses. Les représentants des personnels tirent la sonnette d’alarme, évoquant la dégradation du service public, la perte de sens, le malaise grandissant. Au-delà des chiffres, deux visions irréconciliables du service public s’affrontent, et la ligne de fracture semble loin de se refermer.